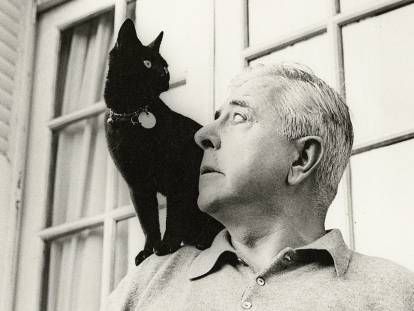
Objet de fascination pour les poètes, personnage tour à tour énigmatique, sensuel voir divin, le chat accompagne la poésie depuis l’Antiquité. Loin d’être un sujet trivial, il est traité avec le plus grand sérieux y compris par des auteurs parmi les plus éminents, tels Charles Baudelaire (1821-1867), Guillaume Apollinaire (1880-1918) ou encore T.S Eliot (1888-1965).
Voici 25 poèmes avec un chat, précédés d’un propos concernant la place de cet animal dans la poésie et l’évolution au fil des siècles du regard que les auteurs posent sur lui.
Les premières traces de la présence d’un chat dans la poésie remontent à l’Égypte ancienne. Cet animal y est souvent considéré comme un représentant des dieux sur Terre, et est à ce titre vénéré par la population.
Bastet, la déesse protectrice du foyer, des enfants et des femmes enceintes est d’ailleurs représentée sous la forme d’un petit félin. Les hymnes rédigés à sa gloire constituent donc dans un sens les premiers poèmes avec un chat.
Les plus anciens ayant été retrouvés datent du Moyen Empire, qui couvre une période allant d’environ 2033 avant J.-C. à 1786 avant J.-C. La plupart sont inscrits directement sur les murs des temples et des sanctuaires - c’est le cas par exemple sur celui de Tel Basta, dédié à Bastet et situé dans l’actuelle ville de Zagazig. Toutefois, on trouve également d’autres poèmes dédiés à la déesse sur des stèles et des statues la représentant. Ceux figurant sur des papyrus sont en revanche extrêmement rares.

Plusieurs siècles séparent les hymnes poétiques dédiés à la déesse Bastet du premier véritable poème dédié à un chat. Intitulé Pangur Bán (« Pangur le blanc », en français), celui-ci est rédigé au 9ème siècle en vieil irlandais par un moine anonyme qui compare son travail de copiste avec la chasse aux souris de Pangur, le chat présent dans son monastère.
Long de 32 vers répartis en huit couplets égaux, il figure dans un manuscrit intitulé Reichenauer Schulheft (« Le Primer de Reichenau », en français), conservé à l’abbaye Saint-Paul du Lavanttal, en Autriche. Plusieurs traductions en anglais existent, mais il n’a en revanche jamais été traduit officiellement en français.
Le chat est aussi évoqué brièvement dans Altercatio inter filomenam et bubonem (« La chouette et le rossignol »), plus connu sous son titre anglais The Owl and the Nightingale, un poème écrit en Moyen anglais entre le 12ème et le 13ème siècle par un auteur non identifié.
Cette oeuvre met en scène un débat entre une chouette et un rossignol qui critiquent leurs comportements respectifs. Le chat y est cité par deux fois à partir du vers 810 : ses qualités de chasseur noctambule sont comparées à celles du renard.
Toutefois, cet animal reste de manière générale rarement évoqué dans la poésie du Moyen Âge.
Les choses commencent à évoluer à partir de la Renaissance, qu’on situe entre le 15ème et le 17ème siècle en Europe. Certes, les personnages de la mythologie gréco-romaine fascinent davantage les poètes de cette époque que le monde animal, mais il existe des exceptions.
Ainsi, alors qu’en France émerge la Pléiade, un groupe de poètes se donnant pour objectif d’enrichir le français pour le rendre aussi prestigieux que le latin, Joaquim du Bellay (1522-1560), l’un des confondateurs du mouvement, ne s’interdit aucun sujet. En 1588, à la mort de son chat Chartreux Belaud, il rédige en son honneur Épitaphe d’un chat, un des premiers éloges funéraires jamais dédiés à un animal de compagnie. L’oeuvre est très en avance sur son temps, puisqu’il faut attendre le 18ème siècle avant que ce genre de poèmes ne se démocratisent.
Les animaux, et notamment les chats, intéressent une partie des auteurs de la Renaissance, car il est possible de dresser des parallèles entre leurs qualités et leurs défauts et ceux des êtres humains, afin d’en tirer des leçons de morale. Dans la littérature de l’Antiquité, ce procédé avait donné naissance aux fables. Ce genre littéraire signe son retour en grâce, mais les auteurs qui y ont alors recours y apportent une dimension poétique nouvelle. En effet, ils les rédigent en vers et prêtent une attention particulière au vocabulaire, aux rimes ainsi qu’à la musicalité du texte.
L’un des plus célèbres est le Français Jean de la Fontaine (1621-1695), qui signe plusieurs fables avec un chat : notamment Le Chat et un vieux rat, Le Chat, la Belette et le Petit Lapin, Le Chat et les Souris, Le Singe et le chat ou encore Le Rat et le Chat-huant. Le petit animal y a cependant rarement le beau rôle : l’auteur l’emploie surtout pour dénoncer, par le biais de métaphores, les comportements négatifs de certaines personnes – en particulier la fourberie et la paresse.

De l’autre côté du monde, le chat fascine bien davantage les poètes. C’est le cas notamment au Japon, où il s’impose au 17ème siècle comme un sujet de prédilection des auteurs de haïkus, ces très courts poèmes dont la paternité est attribuée au poète japonais Bashō Matsuo (1644-1694).
Isaa Kobayashi (1763-1828), un des grands maîtres du genre, leur dédie par exemple plus de 330 poèmes évoquant leur quotidien. On peut d’ailleurs les découvrir dans la langue de Voltaire grâce à une traduction effectuée par le poète français Segan Mabesoone (né en 1968), qui les a réunis dans un ouvrage publié en 2016 et sobrement intitulé Haïkus sur les chats.

L’attachement sentimental de plus en plus prononcé pour les chats au 18ème siècle contraste avec la rationalité qui caractérise la littérature de cette époque marquée par l’esprit des Lumières.
D’ailleurs, le poète anglais Thomas Gray (1716-1771) va même jusqu’à se moquer du fait que ses contemporains humanisent de plus en plus les animaux domestiques dans un poème humoristique intitulé Ode on the Death of a Favourite Cat, Drowned in a Tub of Goldfishes (« Ode sur la mort d’un chat préféré, noyé dans une bassine de poissons rouges ») et rédigé en 1747.
Il décide de composer cette œuvre lorsqu’il reçoit une lettre d’un ami l’informant du décès de son chat dans les conditions en question. Sidéré que l’on consacre du temps et de l’énergie à faire part à ses proches d’une telle nouvelle, il conte la mort de cet animal en imitant le style héroïque du poète anglais Alexander Pope (1688-1744).
Tous les poètes de l’époque n’adhèrent cependant pas froidement à cette vision cartésienne. Par exemple, l’Anglais Christopher Smart (1722-1771) traite sa relation avec son propre chat avec le plus grand des sérieux. Il l’évoque dans un poème aux accents religieux intitulé Jubilate Agno, qu’il écrit alors qu’en 1757 il est interné à l’hôpital psychiatrique de St Lucke avec pour seule compagnie son petit félin Jeoffry.
Il y déclare ainsi à son sujet qu’il n’est rien de moins que « le serviteur du Dieu Vivant ». Pour lui, les représentants de la gent féline sont en effet dévoués à Dieu et lui adressent en permanence des louanges à travers toutes sortes de comportements. Il s’évertue ainsi à décrire ces derniers et expliquer en quoi ils sont à ses yeux des actes de soumission divine.
Il est certes permis de douter de la santé mentale de Christopher Smart, mais dans sa manière de tisser des liens entre le divin et le monde animal, il peut être vu comme un précurseur d’une sensibilité qui se développe ensuite plus largement au 19ème siècle. En effet, sous l’influence des romantiques et des symbolistes, la poésie explore alors de plus en plus la spiritualité inhérente au monde naturel.

Au 19ème siècle, les poèmes avec un chat s’inscrivent davantage dans le sillage de celui de Christopher Smart que de celui de Thomas Gray. Plusieurs auteurs témoignent ainsi de leur fascination pour cet animal, et vont jusqu’à donner un sens profond au moindre de ses faits et gestes. Le siècle est d’ailleurs marqué par l’émergence du symbolisme, un mouvement littéraire qui cherche à donner un sens caché aux choses.
De plus en plus appréciés comme animaux de compagnie, les chats intéressent à ce titre de grands noms de la poésie française, notamment Charles Baudelaire (1821-1867). Celui-ci va jusqu’à leur octroyer une dimension divine dans un poème intitulé Les chats, publié en 1857 dans son recueil Les Fleurs du mal. Il s’y demande en effet si son petit félin ne serait pas en fait un véritable dieu jugeant ses moindres faits et gestes de son regard pénétrant.
Manifestement d’accord, le poète français Maurice Rollinat (1846-1903), lui aussi rattaché au mouvement symboliste, lui répond avec Le chat, paru en 1883. Il déclare dans le premier vers « Je comprends que le chat ait frappé Baudelaire » et fait de cet animal une métaphore de la liberté.
Quelques décennies plus tard, en 1919, le poète irlandais William Butler Yeats (1865-1939), qui est d’ailleurs très influencé par les symbolistes français, signe quant à lui le texte Cat and the Moon (« Le Chat et la Lune »). Il y fait d’un chat dansant au clair de lune le symbole de l’autonomie et de la spontanéité.
Tous les symbolistes ne voient cependant pas les choses de manière aussi positive. En effet, les superstitions concernant les chats ont la vie dure : même au 19ème siècle, certains auteurs perpétuent une vision datant du Moyen Âge en associant la gent féline à la tentation, au mal et aux sorcières. C’est par exemple le cas du célèbre poète français Paul Verlaine (1844-1896), qui avec son poème Femme et chatte, publié en 1866 dans son recueil Poèmes saturniens, fait un lien négatif entre la figure féminine et le chat, diabolisant les deux à la fois.
En plus du symbolisme, le 19ème siècle est aussi celui du romantisme. Les poètes de ce mouvement littéraire s’intéressent tout particulièrement à la nature ainsi qu’au monde animal, et donnent beaucoup d’importance à leur ressenti personnel.
C’est dans ce contexte qu’apparaissent plusieurs éloges funéraires dédiés à des animaux de compagnie. Le plus célèbre est peut-être Epitaph to a dog (« Épitaphe pour un chien », en français), que le poète britannique Lord Byron (1788-1824) consacre en 1808 à son Landseer Boatswain et fait inscrire sur le monument funéraire qu’il érige en son honneur.
La gent féline n’est cependant pas en reste. Par exemple, au 19ème siècle, la poétesse anglaise Christina Rossetti (1830-1894) dédie On the death of a cat (« Au sujet de la mort d’un chat »), à Grimalkin, son petit félin décédé, et y exprime tout le chagrin qu’elle ressent.
À cheval entre le romantisme et le symbolisme, la grande poétesse américaine Emily Dickinson (1830-1886) a elle aussi des choses à dire sur cet animal pas comme les autres. Elle livre une minutieuse observation de son comportement de chasseur dans Cat (« Chat »), composé à une date inconnue. Avec son rythme saccadé, ce texte préfigure déjà certaines évolutions stylistiques qu’on retrouve plus tard dans la poésie moderniste. Le ton est aussi résolument plus sombre que celui des autres poèmes consacrés à un chat. Alors qu’il échoue à capturer sa proie, le personnage principal du texte devient pour l’autrice à la fois le symbole d’un espoir déçu et une source de danger.
À partir du 20ème siècle, quel que soit leur genre littéraire, les écrivains voient de plus en plus dans le chat l’incarnation même de la liberté. Dès lors, pour les auteurs qui s’intéressent à lui (et notamment les poètes), ce n’est plus le compagnon domestique qui les intéresse, mais plutôt l’animal qui vagabonde librement.
Publié en 1939 par le poète américain T.S Eliot (1888-1965) et entièrement consacré à la gent féline, le recueil de poésie Le Guide des chats du vieil Opossum (Old Possum's Book of Practical Cats, en version originale) illustre parfaitement ce changement.
Il offre en effet une vision romanesque de la vie des chats de gouttière tout au long de 15 textes farfelus initialement destinés aux enfants, et dont la musicalité des vers est particulièrement travaillée. Ces poèmes interconnectés décrivent la vie cachée des représentants de la gent féline : on y apprend ainsi qu’ils ont tous un nom secret et qu’ils appartiennent à une société parallèle tout aussi sophistiquée que celle des humains.
Plus profonds qu’ils n’y paraissent, ces poèmes sont aussi de véritables satires de la société londonienne. Ils sont si populaires qu’ils finissent par être adaptés en comédie musicale en 1981 par le compositeur britannique Andrew Lloyd Webber (né en 1948).
Le célèbre auteur chilien Pablo Neruda (1904-1973), prix Nobel de poésie en 1971, se penche lui aussi sur les chats avec Oda al Gato (« Ode au chat ») publié en 1959 dans son recueil de poésie Navegaciones y regresos (non traduit en français). Il y fait l’éloge de l’indépendance de cet animal et de sa singularité en écrivant qu’alors que « le chien est un lion sans orientation » et « la mouche étudie pour devenir hirondelle », le chat lui « ne veut qu’être chat ».
Les poèmes contemporains avec un chat ne brillent guère par leur originalité. En revanche, ils sont marqués par une multitude d’influences qui traversent les âges et les courants littéraires. Ainsi, le chat dans la poésie contemporaine est un être polyforme : il peut être aussi bien un symbole de liberté qu’un personnage romantique ou un compagnon de vie, éventuellement au sein d’une seule et même œuvre.
Ce mélange est manifeste par exemple dans le poème Cat (« Chat »), de l’auteur américain Lawrence Ferlinghetti (1919-2021) : l’auteur compare son petit compagnon au sphinx de l’Égypte ancienne, l’imagine capable de voir les fantômes et affirme même qu’il peut écouter « la musique de l’univers », mais préfère le confort de son foyer au « bourdonnement des mystères de l’univers ».
L’Américaine Sylvia Plath (1932-1963) se penche elle aussi sur la gent féline avec en 1957 son poème Ella Mason and her eleven cats (« Ella Mason et ses onze chats »), et livre une vision paradoxale des chats. En effet, elle présente les onze chats du personnage principal comme une source de confort pour leur maîtresse, mais aussi comme d’inquiétantes créatures hantant son domicile.
Enfin, alors que les connaissances sur les représentants de la gent féline s’enrichissent au fil des années et qu’on les comprend désormais mieux, certains poètes voient aussi en eux un miroir capable de refléter des peurs et préoccupations des humains.
C’est notamment le cas de la célèbre romancière canadienne Margaret Atwood (née en 1939), qui les affectionne particulièrement et leur dédie plusieurs poèmes. Dans Ghost Cat (« Chat Fantôme »), publié en 2020, elle utilise la démence de son proche chat domestique pour aborder un thème susceptible de concerner tout être humain : la désintégration progressive de l’esprit.